Utiliser les données pour le bien collectif
À qui revient la décision de déterminer ce qui est socialement bénéfique? Et pour qui?
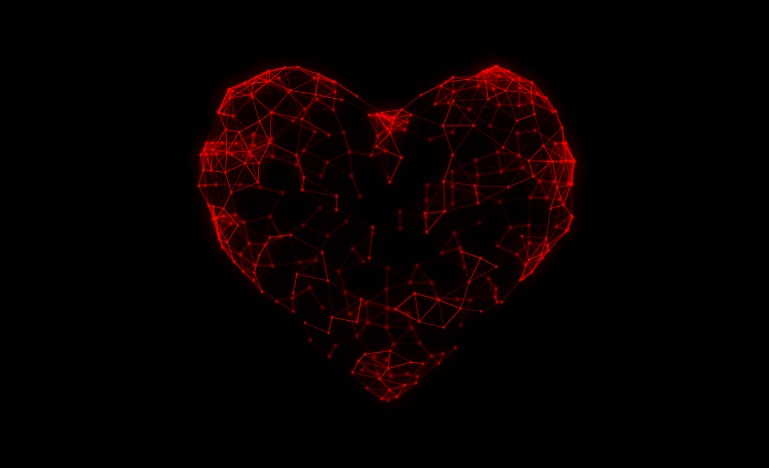
Les données peuvent s’avérer un outil efficace pour améliorer la vie des citoyens, elles permettent autant de faire des choix politiques bien éclairés pour relever le défi climatique que d’offrir aux citoyens de meilleurs soins de santé et des services plus efficaces. Selon Chelsey Colbert, qui a animé une table ronde lors du Symposium en ligne de l’ABC sur le droit de la vie privée et de l’accès à l’information qui a eu lieu en novembre, utiliser les données pour favoriser le bien collectif peut en outre contribuer à renforcer la confiance de la population envers des projets qui ont recours à des données à caractère nominatif.
Bien entendu, n’importe qui peut prétendre utiliser des données dans le but de générer des retombées sociales positives. Qu’est-ce que ça signifie en fait? Les gouvernements, les entreprises et les organismes sans but lucratif en vantent tous les mérites. « On peut donc se demander si l’expression “données en tant que bien social” ne relève en fait que du marketing ou des relations publiques, ou si elle signifie vraiment quelque chose. » C’est la question que Chelsey Colbert a posée aux participants à la table ronde.
Le projet de loi C-11 est un bon point de départ pour la discussion. Il a été déposé l’an dernier dans le but de mettre à jour le régime de protection des renseignements personnels dans le secteur privé au Canada. Bien qu’il soit finalement mort au Feuilleton avant les élections, il renfermait une disposition qui permettait la communication à une entité réglementaire de renseignements personnels anonymisés à l’insu ou sans le consentement de la personne visée, pourvu que ce soit à des fins socialement bénéfiques. Parmi les entités envisagées par le projet de loi figuraient les gouvernements, les établissements de soins de santé, les établissements d’enseignement postsecondaire, les bibliothèques publiques et toute organisation mandatée, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, pour réaliser une fin socialement bénéfique.
Selon Dean Eurich, professeur à l’École de santé publique de l’Université de l’Alberta, les gens n’arrivent pas à s’entendre sur la signification de cette disposition. « Cela fait 20 ans que nous essayons de libérer des données et j’espère que le projet de loi C-11 permettra de surmonter les différends (s’il est présenté à nouveau), dit-il. Je suis cependant un peu sceptique quant à savoir s’il finira par aboutir. » Il note que notre régime de protection des renseignements personnels actuel permet un certain partage de données. « Ce n’est que l’application et l’interprétation de la loi qui semblent être différentes selon le groupe qui s’y intéresse. »
En tant que chercheur, le professeur Eurich explique qu’il a accès à des données anonymisées par l’entremise de Santé Alberta ou de ses organismes homologues de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. « C’est tout de même extrêmement difficile pour moi de transmettre ces données à des personnes qui ne font pas partie de mon équipe de recherche en raison des diverses conventions qui ont été mises en place à l’université. » Quant aux organisations commerciales, c’est pratiquement impossible – et ce même si le rôle qu’elles jouent au sein de nos systèmes de santé est de plus en plus important.
Une solution prometteuse est de recourir aux techniques d’apprentissage automatique pour améliorer la protection de la confidentialité des données anonymisées – une pratique que l’on appelle la fabrication de données de synthèse. Pour ce faire, on utilise des dossiers de patients individuels et des données administratives sur la santé. « Nous évaluons les schémas pathologiques qui sont répertoriés dans le système de santé du monde réel et les utilisons pour créer une population complète de patients qui reproduit le monde réel, mais qui est complètement fictive », explique Dean Eulrich. Ses collaborateurs et lui ont généré un ensemble de données sur 80 000 consommateurs d’opioïdes fictifs en Alberta. Les données de synthèse sont utiles, car elles « reproduisent les schémas de soin et certains des effets indésirables découlant de la consommation d’opioïdes ». Résoudre le défi technique demeure toutefois la partie la plus simple. Convaincre les commissaires provinciaux à la protection de la vie privée et les autorités sanitaires que les données sont fictives et devraient être communiquées à une fin socialement bénéfique est beaucoup moins évident.
Il est légitime de se demander si les personnes et entités possédant des intérêts commerciaux ne devraient pas être exclues de celles autorisées à partager des données anonymisées à des fins socialement bénéfiques. « De mon point de vue, j’espère que ce ne sera pas le cas, dit-il. Il y a tant d’éléments qui influencent les services de santé et leur utilisation qui ne font pas partie du système de santé et qui sont intégrés à des entités commerciales. » Si Loblaw’s partageait les données qu’elle possède sur ses clients, nous pourrions en apprendre sur leurs habitudes alimentaires et les ventiler par secteur géographique. « Cela pourrait s’avérer un déterminant important des phénomènes de santé auxquels on assiste dans une collectivité donnée », selon lui.
On entend le même son de cloche du côté du bureau de statistique national. « Nous produisons des renseignements sur l’économie canadienne. Nous produisons des renseignements sur la santé des Canadiens et Canadiennes et sur leurs conditions socio-économiques. Nous produisons des renseignements sur l’environnement », explique André Loranger de Statistiques Canada. La valeur de ces données repose sur notre capacité à faire des liens et à en tirer des conclusions, ajoute-t-il. Le but est donc de rendre le plus de données possible accessibles au public – dont une grande partie se trouve entre les mains du secteur privé.
Un bon exemple est le programme lancé par TELUS Les données au service du bien commun, dont l’objectif est d’« aide[r] à résoudre les problèmes sociaux urgents d’une façon qui protège la vie privée et inspire la confiance ». Selon la chef des données et du Bureau des relations de confiance de TELUS, Pamela Snively, l’entreprise a travaillé avec des experts pendant plusieurs années sur diverses méthodes d’anonymisation de ses données sans fil. Lorsque la pandémie est arrivée, TELUS aurait été en mesure de les rendre accessibles à des chercheurs qui tentaient d’établir des scénarios pour aider les autorités à coordonner leurs interventions sanitaires. Il a d’abord fallu redoubler d’efforts pour convaincre les organismes de réglementation, ainsi que la clientèle des entreprises. TELUS a ensuite approché les représentants des médias pour présenter ses arguments en faveur du partage des données. « Tout le monde était activement à la recherche de solutions à la crise de la pandémie », rappelle Pamela Snively. Mais même en situation d’urgence, les organismes gouvernementaux craignaient une réaction négative du public. D’où l’importance d’adopter une démarche proactive et transparente dans la mise en œuvre du programme et de montrer que l’entreprise fonctionne avec une « rigueur absolue », précise-t-elle.
C’est une chose de mobiliser les gens dans une situation d’urgence. Or, comme l’a souligné Pamela Snively durant la séance de discussion, les organisations sont frileuses sur la question du partage de données en l’absence d’un cadre très précis. « Le risque de répercussions sur la réputation est trop important, indique-t-elle. Nous ne voulons pas perdre de clients parce qu’ils sont insatisfaits de la façon dont nous avons traité leurs données. » Mais est-ce raisonnable de s’attendre, en tant que société, à ce que nous puissions définir ensemble les contours de ce cadre, particulièrement en temps normal, alors qu’aucune pandémie ne fait rage?
Une partie du problème vient du fait qu’on ne peut pas faire appel à un seul public pour gagner la confiance du public au sens large, explique Lisa Austin, titulaire de la chaire de recherche en droit et technologie à l’Université de Toronto. « Nous avons de multiples publics et il existe de multiples groupes sociaux. Et cela est vraiment, vraiment très important dans certains contextes. » Pour illustrer son propos, elle cite les travaux réalisés par le mouvement pour la souveraineté des données autochtones, qui plaide en faveur de laisser les communautés autochtones déterminer ce qui est socialement bénéfique pour elles et la façon dont leurs données sont utilisées. « Voilà un cadre très précis, reconnaît-elle. Mais il s’agit d’un cadre précis de gouvernance communautaire. »
Il n’est pas rare que les communautés traditionnellement défavorisées se méfient de la façon dont leurs données sont utilisées, selon Lisa Austin. « La question demeure : à qui revient la décision de déterminer ce qui est socialement bénéfique? Qui décide pour qui? Je pense que le contexte viendra où il sera absolument crucial de répondre à ces questions et nous pourrions avoir besoin de mécanismes spéciaux pour y parvenir. »
Entre autres, il faudra s’entendre sur les normes qui sont reconnues et homologuées d’un endroit à l’autre. « Je ne trouve pas que le projet de loi C-11 traite suffisamment de cet enjeu et j’estime qu’il s’agit pourtant d’un élément important », ajoute la professeure Austin.


